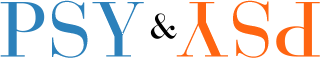
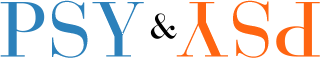
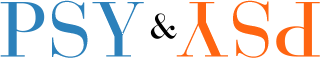

Une personne dépressive sur deux est résistante aux traitements conventionnels. Le taux de rémission se situe encore nettement plus bas dans les cas de dépression bipolaire. Il est donc nécessaire d’agir. Dans le cadre du Congrès-PSY 2019, Gregor Hasler évoquera des problèmes anciens et des approches innovantes dans le traitement de la dépression.
L’importance des dépressions ne se limite pas au quotidien clinique. La société et l’économie sont également très concernées. Selon l’Office fédéral de la statistique, l’incidence d’une dépression majeure se situait en 2017 à 7.8% pour les femmes et 9.5% pour les hommes. En comparaison avec d’autres maladies psychiques, elles sont par ailleurs beaucoup plus fréquentes : la prévalence sur la vie se situe ainsi autour de 15-20% pour les dépressions et d’1% seulement pour la schizophrénie et le trouble bipolaire. En outre, près de la moitié de toutes les rentes AI sont actuellement déjà attribuées à des personnes souffrant de dépression.
Une grande partie de ce que nous faisons est juste. Une résistance élevée au traitement se manifeste pourtant, notamment parce que les dépressions évoluent différemment selon les cas et que par ailleurs les réactions à une thérapie sont individuelles. A quoi viennent s’ajouter les effets secondaires qui ont une grande influence sur l’observance souvent déjà limitée des personnes concernées. Enfin, les antidépresseurs disponibles ont tous des mécanismes d’action très similaires.
Lorsqu’un traitement ne fait pas effet, une observation systématique de la situation sous l’angle de la pseudo-résistance devrait toujours s’imposer en premier lieu. Le traitement est-il insuffisant ? Le dosage est-il par exemple trop bas ? Des facteurs psychosociaux sont-ils passés inaperçus ? Le diagnostic est-il juste ? Nous pouvons ensuite nous demander s’il est possible d’améliorer la situation clinique par la psychothérapie, le sport, l’alimentation ou le sommeil par exemple. A cet égard, les directives internationales proposent de nombreuses options que nous discuterons lors du Congrès-PSY.
Les méthodes ECT/TMS constituent une approche. Elles rencontrent une acceptation croissante depuis quelques années. Comme nous le savons tous, la dépression est également liée aux hormones. De nouvelles perspectives de recherche dans ce sens s’offrent ainsi. La kétamine, de par ses effets antidépresseurs à un dosage très faible déjà, propose une approche novatrice d’importance. La « communauté des chercheurs » n’est pas seule à s’enthousiasmer pour les premiers résultats des études sur le sujet. Le botox – qui paralyse le muscle corrugateur, responsable des sentiments négatifs – est une autre méthode encore très expérimentale. Là aussi, les résultats des premières études sont très encourageants. En ce qui concerne la thérapie par neurostimulation vagale qui agit sur l’axe abdomen-cœur-cerveau, seules les études d’observation sur le long terme indiquent de possibles effets. De premiers résultats relatifs à une stimulation non invasive du nerf vagal sont très prometteurs.
Je souhaite démontrer ce qui peut être fait avec les possibilités actuelles et comment nous pouvons améliorer les effets de la thérapie. Pour ce faire, je présente de nouvelles méthodes en combinaison avec les résultats d’études pertinents qui les sous-tendent. Dans la discussion sur cette diversité inédite, je veux ouvrir de nouvelles perspectives et aussi susciter de l’espoir. Le plénum a l’opportunité de se confronter de manière critique aux résultats et d’intégrer avec pertinence le spectre thérapeutique à sa propre application clinique.
Le Dr. méd. Gregor Hasler est Professeur en psychiatrie et psychothérapie à l’Université de Fribourg et médecin chef au Réseau fribourgeois de santé mentale. Le médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie s’est spécialisé aux États-Unis sur l’influence du stress sur la santé physique et psychique. Gregor Hasler est auteur des recommandations thérapeutiques suisses relatives aux troubles bipolaires et coauteur de lignes directrices internationales de traitement de la dépression. Son actuelle activité de recherche se concentre sur les interactions des facteurs sociaux, psychiques et biologiques dans le cadre de la prévention et du traitement des troubles psychiques.