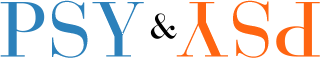
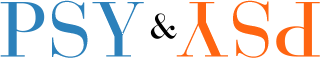
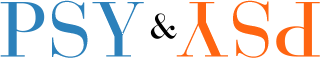

Une crise offre aussi l’opportunité de nouvelles approches. La pandémie du coronavirus ne fait pas exception, elle qui a repositionné les consultations « virtuelles ». Il est l’heure maintenant de maximiser l’utilité des consultations – traditionnelles et nouvelles – et de les concilier de façon optimale.
Une pandémie globale se produit environ une fois par génération. Pour relever les défis qu’elle pose, le recours à des expériences passées n’est par conséquent possible que de façon très limitée. La crise de la COVID-19 remplit ainsi les critères fondamentaux d’une crise. L’un d’entre eux se caractérise par la nécessité de recourir à des solutions non encore appliquées à ce jour, voire d’en développer d’entièrement nouvelles. L’un des principaux défis de la pandémie de COVID-19 de cette année a été, et continue d’être, l’accès aux soins psychiatriques en garantissant des mesures préventives d’infection concomitantes. Une extension rapide des offres de télémédecine permet de combler en grande partie la soudaine lacune de prise en charge prévisible des groupes de population particulièrement à risque. La notion de télémédecine désigne des procédures médicales (diagnostic, thérapie, etc.) palliant la distance spatiale ou temporelle à l’aide de technologies de communication électroniques. On parle dans ce cas d’interventions asynchrones (p.ex. courriels, sms etc.). Des moyens de télécommunication peuvent à cet effet être utilisés entre spécialistes et patients (front-office) ou entre spécialistes (back-office).
Le recours à des moyens de télémédecine n’est certes pas nouveau et ces dernières années, des tentatives récurrentes de promouvoir ce type d’offres ont été faites avec plus ou moins de succès. Par ailleurs, ces dernières années ont vu croître l’offre de plateformes comprenant une transmission vidéo de qualité élevée et garantissant la confidentialité. Celles-ci ont soit été développées spécifiquement pour le domaine médical, soit peuvent en général être rapidement adaptées à ses besoins particuliers. À titre d’exemples, on peut citer Zoom, Blue Jeans, Doxy.me, TheraNest, SimplePractice et Vsee. Avec la pandémie, la télémédecine, et la télépsychiatrie en particulier, ont connu un essor réjouissant.
La psychiatrie se prête particulièrement à l’utilisation des moyens de télémédecine. Comparée aux autres disciplines médicales, elle repose en effet dans une plus grande mesure sur le dialogue. Déjà avant la pandémie de COVID-19, de nombreuses analyses ad hoc ont pu démontrer que, dans bien des cas, la « consultation virtuelle » représente pour les patients et les spécialistes psychiatriques une alternative acceptable à la consultation traditionnelle. Les patients apprécient surtout la flexibilité, le confort de l’environnement privé (sentiment de normalité et/ou d’intervention sur mesure) et l’absence de temps de trajet et des coût afférents. Des preuves scientifiques en nombre suffisant existent entretemps également quant à l’efficacité, à l’économicité et en particulier à l’amélioration de l’accès à la prise en charge psychiatrique. Les moyens de communication aujourd’hui disponibles peuvent à cet égard être utiles aussi bien dans le contact avec les patients (front-office) que dans l’organisation du traitement (back-office).
Un autre aspect de l’essor de la télépsychiatrie rarement débattu – mais peut-être le plus intéressant sur le long terme – est le fait qu’il favorise et, on peut l’espérer, accélère la transition vers une psychiatrie de proximité, plus accessible, plus collaborative, plus centrée sur le patient. Par définition, une crise véhicule l’opportunité de nouvelles approches, mais aussi la possibilité d’un renforcement et/ou d’une chronicisation de certains problèmes. Le retour à un pilotage par trop rigide de l’activité qui pourrait briser l’actuel élan d’innovation fait assurément partie des risques. Les procédures basées sur des algorithmes ne prévoient pas les innovations à priori et peuvent ainsi réduire le potentiel de gestion de crise. Pour autant, l’abus des nouveaux moyens de communication à des fins de surveillance est un risque supplémentaire. Le télétravail, par exemple, induit ainsi une certaine liberté, mais aussi le risque de l’effacement des limites entre vie privée et professionnelle.
La crise de la COVID-19 a certes fait bouger certaines choses, mais il s’agit maintenant de maintenir cet élan, de consolider les acquis et d’encourager d’autres développements. En Suisse, les offres de télépsychiatrie étaient jusqu’alors plutôt l’exception et il faut partir de l’idée que leur application systématique nécessitera encore un certain soutien lorsque l’épidémie faiblira. Il revient maintenant en première ligne aux institutions de maintenir l’élan naissant, de conserver les offres et de les renforcer, de partager les techniques et les expériences et de motiver les late adopters. L’une des priorités devrait être l’intégration des aspects télépsychiatriques dans la formation postgrade et continue. Une attention particulière devra être portée à la suppression des barrières technologiques (tant parmi les patients que parmi les médecins). La promotion du recours à des télétechnologies dans le cadre d’études scientifiques (p.ex. par une utilisation accrue des Ecological Momentary Assessments) devrait également être bénéfique à cet élan. L’un des défis consistera à intégrer les consultations traditionnelles et « virtuelles » dans le temps et l’ordre de manière à pouvoir maximiser les avantages de chaque méthode. Il convient finalement d’attirer l’attention sur le risque que dans l’emballement la rencontre personnelle soit éventuellement négligée, transformant la distanciation physique du début en distanciation sociale au sens propre du terme.
Daniele Zullino est médecin-chef du Service d'Addictologie du Département de Santé Mentale et Psychiatrie des HUG et membre de la conférence de rédaction de psyCHiatrie de la FMPP.